
La Topographie
Par Augustin d'Hautefeuille, CP du Bison (2014-2015)
1. Croquis panoramique
Le croquis panoramique, comme son nom l'indique, représente le panorama vu par l'observateur. Le dessin est souvent facilité par l'utilisation d'un cadre quadrillé dont le quadrillage est reporté sur la feuille de dessin.

On dessine les différents éléments visibles en respectant les distances et les proportions. On évite de colorier des éléments différents de la même couleur. Il ne faut pas oublier de légender son croquis dans un encadré dans un coin non colorié. Il faut également définir une échelle, orienter son croquis en dirigeant sa boussole vers le nord et en marquant les extrémités du croquis par les angles qui correspondent.
2. Croquis topographie
Le croquis topographique représente le terrain comme sur une carte. Il est important de signaler l'échelle approximative du croquis et la direction du Nord Magnétique. Comme la feuille de route, il sert à rejoindre un but sans carte. Suivre un croquis topographique ou en réaliser un demande une bonne maîtrise de l'orientation.
Il faut tout d’abord définir une échelle adapté au croquis par exemple 4carreaux = 10metres. On représente en premier les routes en indiquant les directions aux extrémités du croquis. On représente ensuite les différents bâtiments, forêts, rivières, champs. Chaque élément doit avoir une couleur différente. On note la légende dans un carré dans un coin du croquis. Pour finir, on oriente le croquis avec une rose des vents.


3. Croquis Gilwell
Le croquis Gilwell, également appelé relevé d'itinéraire est d'une réalisation et d'une utilisation délicate : il est donc réservé aux chefs et scouts expérimentés. Il s'agit de dessiner son itinéraire sur route en ligne droite et de spécifier la direction du nord magnétique à chaque changement de direction important.
Ce croquis est réalisé grâce à 4 colonnes :
• La 1re colonne permet de décrire le bas-côté gauche de la route.
• La 2e colonne permet de dessiner la route et ses bas cotés (maisons, bois, curiosités,...).
• La 3e colonne permet de décrire le bas-côté droit de la route.
• La 4e colonne permet de mentionner les distances en kilomètres ou mètres.
La partie dessinée du croquis Gilwell est la même que celle du croquis topo. La différence se situe dans le fait que la route reste toujours droite et qu’à chaque tournant on indique la direction du nord ainsi que son angle par rapport au tournant.
4. Profil topographique
L’objectif du profil topographique est de reporter les variations d’altitudes sur une feuille. Pour cela on utilise les courbes de niveaux présentes sur la carte. On relève d’abord le point le plus haut et le point le plus bas pour convenir d’une échelle. L’abscisse représente le trajet et l’ordonnée le niveau. On colle la carte et la feuille et on reporte tous les points importants (col lac vallée) qu’on a croisé pendant le trajet, sur le graphique. Pour finir on relie tous les points recensé afin d’obtenir une courbe.


5. Relevé topographique
Repérer un élément au centre de la zone et le reporter au milieu de la feuille de papier. Rechercher ensuite quelques points remarquables tout autour de ce repère central, de façon à couvrir un maximum de zones.
Relever la distance de façon précise entre l’élément central et les autres points remarquables, soit par le nombre de pas étalonnés, soit avec un décamètre. Il faut se méfier car, sur des petites distances, le pas aura tendance à être irrégulier : le décamètre ou une ficelle avec des repères tous les mètres seront beaucoup plus précis. Reporter les points remarquables sur la feuille de papier en respectant l’échelle et les orientations. Si le terrain à relever est important, il est préférable d’utiliser la boussole pour relever les azimuts des points remarquables.
Compléter le croquis en dessinant les bâtiments complets, les chemins…
Ne pas oublier d’indiquer l’échelle, la direction du Nord, la date, le nom, et de situer le croquis, de préférence avec les coordonnées Lambert.
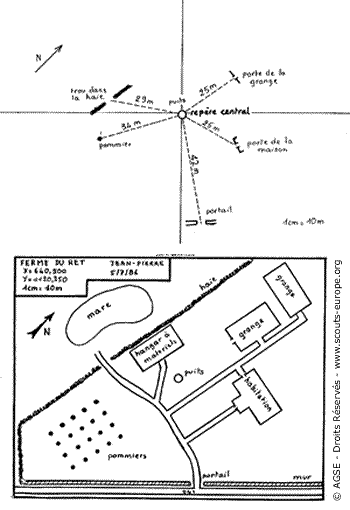

6. Triangulation
La triangulation est utile pour se retrouver sur une carte. Il faut d’abord trouver trois points de repère dans le paysage présent sur la carte (pylône, phare, église, château d'eau,...), ensuite mesurer au moyen d’une boussole l'azimut de ces 3 points. Une fois que l’on connait ces azimuts, on trace à partir de ces points sur la carte des droites dans la direction inverse de leur azimut respectif. L'intersection des droites correspond exactement à notre position sur la carte. Suite aux erreurs de mesures, les droites peuvent former un triangle alors nous nous trouvons à l'intérieur de ce triangle.
On utilise également cette technique en grand jeu : on a trois lieux et un angle est associé à chacun. Il faut orienter la carte, trouver ces lieux et, avec la boussole, tracer des traits selon les angles indiqués. Les 3 traits se croisent au même point : c’est le point auquel il faut se rendre.
7. Azimut
L'azimut désigne, en topographie, l'angle formé entre la direction qu'on suit ou qu'on veut suivre, et le nord magnétique, indiqué par l'aiguille de la boussole. On peut relever un azimut, pour pouvoir indiquer la direction dans laquelle se situe un point de repère, ou suivre un azimut, lorsqu'on se dirige uniquement avec la boussole, on parle alors de marche à l'azimut.
Pour la réalisation de rapports, de croquis panoramiques, ou pour le repérage par triangulation, il peut être important de savoir relever un azimut, c'est à dire de savoir indiquer quel est l'angle entre le nord et la droite qui relie l'observateur à un point observé.

La première étape est de définir le point duquel on veut relever l'azimut : s'il s'agit d'un point de repère bien défini (un arbre, un poteau, un bâtiment précis), ou d'une montagne (dont on prendra le sommet), c'est facile, mais ça n'est pas toujours le cas. Quand le point de repère est plus vague, comme un village, ou une zone du paysage, il faudra choisir un point remarquable au sein du repère donné : le clocher ou le château d'eau du village, une rivière ou une route qui coupe l'horizon, etc.
Une fois le point choisi, on pratique alors une visée azimutale : on utilise la boussole pour viser le point de repère, en s'aidant de la flèche. Cette opération est plus facile avec les boussoles pliantes (comme les célèbres Recta®) munies d'un viseur, voir d'un miroir ; pour les boussoles plates, il faut utiliser la flèche imprimée sur le plateau de la boussole. Ensuite, il faut faire tourner le cadran de la boussole de façon à ce que le nord du cadran coïncide avec le nord magnétique, indiqué par l'aiguille. Une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à lire l'azimut sur le cadran : il est en face de la flèche imprimée sur le plateau (ou le boîtier) de la boussole.


